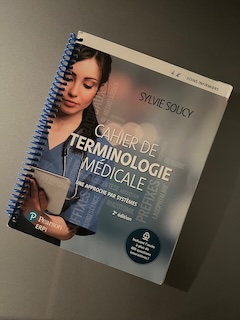Lorsqu’on débarque bien malgré soi dans l’univers des maladies neuro-dégénératives, c’est un peu comme à la sortie d’aéroport dans un pays d’Asie: on n’y comprend rien! Et pour ne rien arranger, nous avons observé des différences non sans impact émotionnel entre le langage de notre culture francophone au quotidien et la terminologie médicale officielle largement issue de l’anglais. Regardons d’un peu plus près certains de ces mots…
D’un côté, le jargon médical – ces deux trois mots compliqués qu’on a griffonnés tant bien que mal sur un bout de papier dans le cabinet du neurologue… Un peu comme si votre vétérinaire vous parlait de votre Felis Catus, variante domestiquée de mammifère carnivore dans la famille des félidés. Ces diagnostics précis, avec leur terminologie officielle, sont indispensables pour le suivi clinique médical et grâce à leur harmonisation internationale, ils clarifient la recherche scientifique; c’est pourquoi nous nous avons appris à les connaître et à les utiliser pour nos recherches et analyses en lien avec la neuro-nutrition EBM. Mais ces mots sont aussi porteurs d’une lourde charge émotionnelle. Par exemple, le diagnostic de SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot en France, maladie de Lou Gehrig aux USA, maladie du motoneurone en Grande-Bretagne) est considéré dans le monde médical comme l’un des plus cruels et dévastateurs pour le patient et sa famille. Mais on peut aussi se rappeler que c’était la « maladie de Stephen Hawking« , scientifique exceptionnel dont le parcours de vie tout aussi exceptionnel entre son diagnostic à 21 ans et son décès à 76 ans a inspiré le film « Une merveilleuse histoire du temps ».
Bien sûr, avant ce rendez-vous de neurologie tant attendu, beaucoup de proches aidants ont cherché par eux-mêmes sur internet (ou avec l’IA) ce que ces drôles de symptômes pouvaient bien cacher… mais là, on prend vite peur devant le défilé de tant d’horreurs page après page. Emma Heming Willis décrit très bien ce processus dans le premier chapitre de son livre, témoignage de son expérience depuis 2022 auprès de son mari l’acteur Bruce Willis, atteint de DFT. Avant de consulter, soucieuse de préserver leur vie privée, elle avait d’abord exploré Google pour essayer de comprendre par elle-même les changements qu’elle observait chez lui au quotidien. Dans ses recherches, elle avait d’abord rêvé d’une tumeur au cerveau qu’on allait pouvoir simplement enlever, et tout reviendrait à la normale pour leur famille. Mais l’imagerie médicale début 2022 n’a pas trouvé de tumeur, juste des changements dans la zone du langage, ce qui expliquait ses difficultés de communication. Ce « diagnostic vague d’aphasie« , pour reprendre ses mots, n’a pas suffi à expliquer les autres troubles: « le chaos s’installait à la maison, et la vie semblait de plus en plus ingérable. J’ai compris que pour apporter le soutien nécessaire à notre famille, je devais comprendre précisément ce à quoi nous étions confrontés« . En novembre 2022, le diagnostic plus précis est tombé: aphasie primaire progressive, une forme de DFT (démence fronto-temporale). Cette précision était nécessaire et lui a été utile dans ses démarches ultérieures pour mieux faire connaître cette maladie. Mais sur le coup, elle a été particulièrement dévastatrice pour son tempérament anxieux. Car, elle le relate très bien, » Google est un endroit sombre pour rechercher la DFT, la forme de démence la plus courante (et certains diraient la plus cruelle) chez les moins de soixante ans« . Ici, attention à une nuance linguistique importante: en anglais, le terme dementia est beaucoup plus neutre et médical que dans notre langue natale. En français, le mot démence est porteur d’une violence implicite, en lien avec son histoire psychiatrique dans notre culture; d’ailleurs, sa définition officielle l’associe explicitement à la gravité du trouble. Dans la mesure du possible, nous utilisons donc sur cette plate-forme d’autres terminologies plus neutres en français, comme « dégénérescence lobaires fronto-temporales » (DLFT), ou plus généralement « troubles neurocognitifs« , et « maladies neuro-dégénératives« .
D’un autre côté, cette volonté humaniste d’adoucir la réalité par un vocabulaire nuancé peut aussi tourner à… la langue de bois. Dès qu’on avance un peu sur un chemin de proche aidant, entouré de professionnels et/ou de bénévoles du terrain (aidants soignants, associations…), on est vite tenté de se réfugier dans leur gentil vocabulaire, leurs paroles empathiques, leur ré-assurance, car ce sont souvent nos seuls guides, bouées de sauvetage dans l’univers douloureux du deuil blanc. Dans une démarche d’éthique bienveillante centrée sur le patient, il est par exemple proposé en France de « remplacer le mot « neuro-dégénératif », chargé d’une terrible et douloureuse connotation d’inéluctabilité, par le mot « neuro-évolutif », porteur d’un sens plus proche de la réalité vécue par les personnes« . Cette terminologie n’a pas, à notre connaissance, d’équivalent international. Par contre, la terminologie de « proche aidant » fait elle-même l’objet d’une proposition spécifique à son équivalent anglophone dans le livre d’Emma Heming Willis. En effet, dans le monde anglo-saxon, on utilise la terminologie « care giver » indifféremment pour les proches aidants de la famille proche et les aidants professionnels, littéralement « donneurs de soin » au patient. Jugeant cette appellation trop vague au regard de son expérience d’épouse aidante, Emma Heming Willis propose dans son livre témoignage de se qualifier elle-même de « care partner« , littéralement « partenaire de soin« . Ces mots sont beaux, ils rassurent, ils nous rappellent que l’évolution d’une maladie neuro-dégénérative n’est pas linéaire (il y a parfois des améliorations temporaires) et que les proches restent un partenaire de vie au-delà du soin (avec encore de belles expériences à vivre). Mais ils ne doivent pas masquer la réalité de la souffrance émotionnelle des proches aidants qui font face au quotidien à des maladies et des partenariats qui évoluent globalement à sens unique… pour eux, parfois, il reste utile d’appeler un chat un chat! Et pour recentrer aussi des mots sur leurs maux à eux, les mots « deuil blanc » en français et « ambiguous loss » en anglais sont bien utiles.